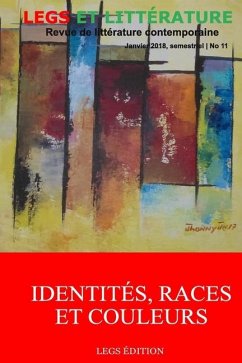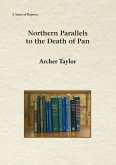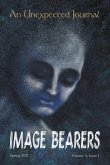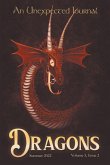Les notions des identités, identifications, de races et de cultures sont au coeur des réflexions des littératures postcoloniales. Identités et cultures étant des entités instables, des phénomènes complexes, dont les usages -qu'ils soient symboliques ou pratiques- feront toujours l'objet de catégories idéologiques particulières. Le corps noir, par exemple, est à un carrefour de son histoire où il est à la fois objet et sujet de représentations, de contre-représentation; il ne cesse de s'inventer ou de se ré-inventer à travers de nouvelles sémiotiques ou de rationalités fictionnelles porteuses de nouvelles décolonialités des représentations racistes et assujettissantes. S'il s'invente, c'est parce que la noirceur tout comme la blancheur des corps sont des masques sociaux visant à naturaliser la domination (Matthieu Renault). Du corps noir connecté au corps saisi dans sa positionalité (Sarah Fila Bakabadio), atlantique ou dans cosmopolitisme. La corporéité noire ne s'enferme pas dans les schèmes de représentation racisant parce qu'elle les défait par la contre- façon (dans le sens de faire contre) et en élaborant son propre contre-discours, parce que, comme tout corps, le corps noir est toujours déjà pris dans les rets de pouvoir -tant le pouvoir colonial raciste que le pouvoir postcolonial reproduisant les formes d'assignation du premier - les formes de résistance s'organisent depuis ces derniers. Ainsi, en plus de s'intéresser à ces anciennes formes d'assignation des corps et des nouvelles formes, des identités autant que des minorités, ce numéro entend explorer les anciennes formes de résistance desdits corps soit sous forme d'esthétisation, de dissidence, de contre-écriture par l'intermédiaire des littératures et des arts particulièrement. [...] Comment hérite-t-on du capital épidermique ou de son corps ? Comment sauver sa peau ( Seloua Luste Boulbina) de ses héritages complexes et ambiguës ? Comment porter/supporter son corps lorsqu'il est déjà abîmé par certains schèmes de représentations dégradants et qu'en est-il lorsqu'on est fatigué d'être réduit à son épiderme ? Que faire de ces mémoires souffrantes (Edlyn Dorismond) qui affectent l'épanouissement et le devenir heureux des anciens corps esclavagisés ? Peut-on être fatigué d'être soi sans se fatiguer de son corps, plus précisément de son épiderme, parce que tout soi se constitue quelque part par l'intermédiaire d'un certain rapport à son propre corps ? Peut-on envisager une déconstruction de la notion de la race en dehors des représentations et schèmes structurants de la colonialité ? Par ce numéro, Legs et Littérature entend créer les conditions de penser et de panser les expériences douloureuses de l'épiderme, des minorités et d'ouvrir des pistes de recherche pour dénicher les lieux de résistance et d'émancipation du corps, des identités. À propos des directeurs du numéro: Carolyn Shread Docteure en Études françaises et francophones de l'Umass Amherst, Carolyn Shread est professeure de Français et de Littérature francophone à Mount Holyoke College et de Traductologie à Smith College. Traductrice de la philosophe Catherine Malabou et de Marie Vieux-Chauvet ( Les rapaces), elle collabore à plusieurs revues dont Palimpsestes, et Traduction, Terminologie, rédaction. Certifiée ès Lettres Modernes de l'École Normale Supérieure, Mirline Pierre détient une maîtrise en didactique des langues de l'Université des Antilles. Elle enseigne la littérature au secondaire et est formatrice à l'Institut français en Haïti. Dieulermesson Petit Frère détient un master 2 en littératures de l'Université Clermont Auvergne et est maître ès Lettres de l'Université des Antilles et de la Guyane. Poète et critique littéraire, il a déjà publié deux recu
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.