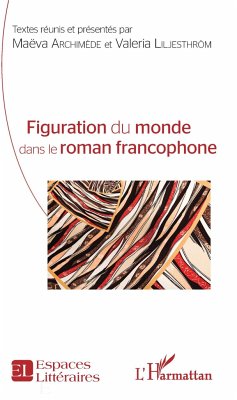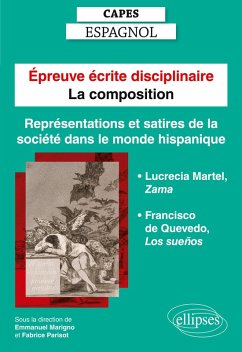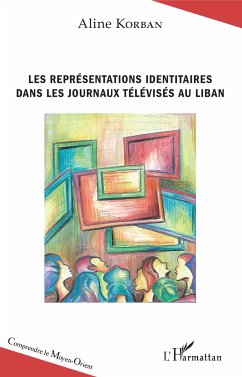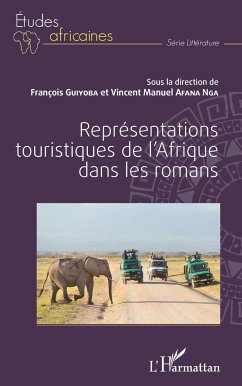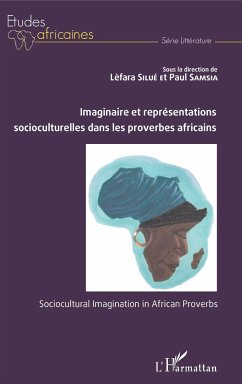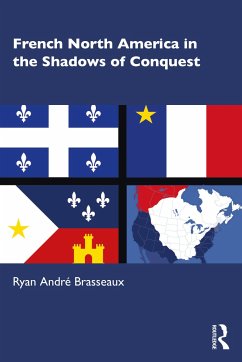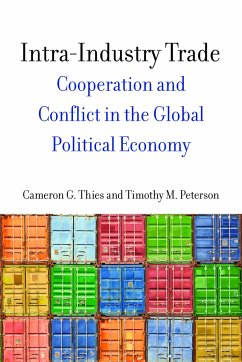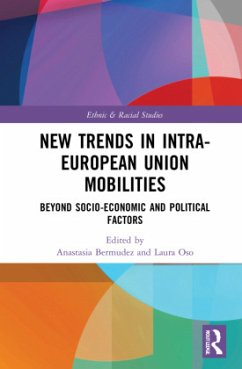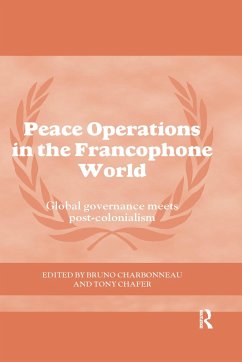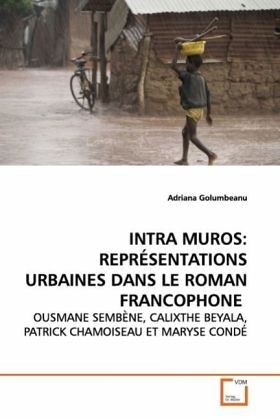
INTRA MUROS: REPRÉSENTATIONS URBAINES DANS LE ROMAN FRANCOPHONE
OUSMANE SEMBÈNE, CALIXTHE BEYALA, PATRICK CHAMOISEAU ET MARYSE CONDÉ
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
60,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
30 °P sammeln!
Cet ouvrage se concentre sur l analyse de la représentation de la ville dans Xala (1973) d Ousmane Sembène, Texaco (1992) de Patrick Chamoiseau, Les honneurs perdus (1996) de Calixthe Beyala, et La Belle Créole (2001) de Maryse Condé. On y met en évidence comment les écrivains choisis (re)créent la géographie urbaine post(-)coloniale et ses habitants et quelles sont les coordonnées qu ils suivent dans ce processus de (re)création. On y identifie les images et les procédés littéraires à côté des causes extérieures, économiques, sociales, raciales ou culturelles. L'auteur se pr...
Cet ouvrage se concentre sur l analyse de la
représentation de la ville dans Xala (1973) d
Ousmane Sembène, Texaco (1992) de Patrick
Chamoiseau, Les honneurs perdus (1996) de Calixthe
Beyala, et La Belle Créole (2001) de Maryse Condé.
On y met en évidence comment les écrivains choisis
(re)créent la géographie urbaine post(-)coloniale et
ses habitants et quelles sont les coordonnées qu ils
suivent dans ce processus de (re)création. On y
identifie les images et les procédés littéraires à
côté des causes extérieures, économiques, sociales,
raciales ou culturelles. L'auteur se propose de
mettre en relief les structures urbaines et les
réseaux territoriaux, tout en montrant comment
l effet de spatialisation est obtenu, par quels
procédés littéraires et en quel but, autre que
purement esthétique. On souhaite faire ressortir
les hiérarchies et les interdépendances qui se
trouvent à l intérieur des espaces urbains (é)clos
et que gouvernent ceux qui les ont construits ou
les habitent. Un chapitre important est consacré à
l analyse du rapport des femmes avec la spatialité
et l écriture urbaines.
représentation de la ville dans Xala (1973) d
Ousmane Sembène, Texaco (1992) de Patrick
Chamoiseau, Les honneurs perdus (1996) de Calixthe
Beyala, et La Belle Créole (2001) de Maryse Condé.
On y met en évidence comment les écrivains choisis
(re)créent la géographie urbaine post(-)coloniale et
ses habitants et quelles sont les coordonnées qu ils
suivent dans ce processus de (re)création. On y
identifie les images et les procédés littéraires à
côté des causes extérieures, économiques, sociales,
raciales ou culturelles. L'auteur se propose de
mettre en relief les structures urbaines et les
réseaux territoriaux, tout en montrant comment
l effet de spatialisation est obtenu, par quels
procédés littéraires et en quel but, autre que
purement esthétique. On souhaite faire ressortir
les hiérarchies et les interdépendances qui se
trouvent à l intérieur des espaces urbains (é)clos
et que gouvernent ceux qui les ont construits ou
les habitent. Un chapitre important est consacré à
l analyse du rapport des femmes avec la spatialité
et l écriture urbaines.