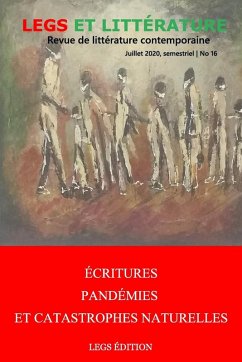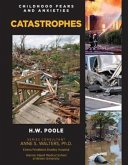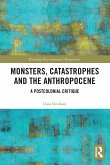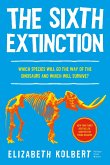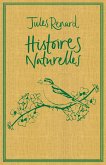L'écriture de la pandémie et des catastrophes naturelles ne peut être que désengagée, débordée et fragmentée, tant elle retranscrit l'anéantissement d'un univers familier qui se rétracte à la représentation. C'est pourquoi, il est judicieux de mettre en évidence le pouvoir de l'écriture contemporaine à dire ce qui échappe à l'expression lors d'un cataclysme. La littérature, par son pouvoir imaginaire et ses ordres poétiques et esthétiques, n'a de cesse de s'approprier le récit des catastrophes naturelles ou épidémiques qui ont forgé la lignée de son histoire pour instituer une spécificité générique. L'esthétique de l'imaginaire rend compte de la technique discursive dont une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou épidémique, est occasionnée selon l'acte de la sur-appropriation du réel par l'écrivain.[...] La mise en scène du pathos jouit d'une place de choix dans l'analyse de la fiction du désastre. L'objet de celle-ci est en réalité le discours passionnel (répertorie les passions et les fait éclaircir) plus que le discours passionné (expose les passions et les fait auditionner). Le travail de l'écrivain sur la représentation du pathos implique l'étude de sa mise en scène pour interpréter ses différentes conceptions dans la fiction de la catastrophe et la façon dont il le conjugue à l'action, à l'intrigue et à la visée de l'histoire. Ce numéro de Legs et Littérature met en exergue les écritures des pandémies et des catastrophes naturelles dans une optique de problématisation du rôle de la littérature à la résistance face aux cataclysmes et à nous relier, même si confinés entre quatre murs, avec nos autres qui ont vécu, dans une période historique différente, une tragédie similaire. Une telle pensée peut sonner, en temps actuel, tel un espoir, lorsque l'on appréhende le problème au regard du fait que nous ne sommes pas les seuls à combattre la dévastation mondiale provoquée par le Covid-19. La thématique que nous proposons pour le prochain numéro de la revue Legs et Littérature, n° 16, propose moult pistes d'analyses relatives à la catastrophe et à l'épidémie, qu'on tient à mettre en rapport avec ses diverses représentations linguistiques et discursives. La pertinence de ce choix d'à-propos thématique et épistémologique n'est plus à renchérir. La fréquence des catastrophes naturelles (liées aux aléas naturels, comme les séismes, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les collisions d'astéroïdes, etc.) et la flambée des épidémies (la grippe espagnole, la grippe asiatique, la fièvre de Lassa, le virus VIH, le SRAS, le H1N1, l'Ébola, la peste, le choléra, la Covid 19, etc.) justifient l'urgence de les interroger en tant qu'objet de recherche à construire. À l'époque contemporaine, il semble que les désastres naturels et viraux deviennent un mode de vie[1]et une normalité. À propos des directeurs du numéro: Mourad Loudiyi est enseignant-chercheur et formateur au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation de Fès-Meknès. Il a soutenu son doctorat en Approche et poétique des textes, et son HDR en Approches des textes littéraires. Ses publications couvrent des sujets comme les approches des textes littéraires, la didactique de la littérature et la professionnalisation chez les enseignants du FLE. Alma Abou Fakher Alma Abou Fakher est chercheuse en Littératures et civilisations au centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée à l'institut national de langues et civilisations orientales - Paris. Doctorant en Littératures de l'INALCO, ses travaux de recherche portent sur des écritures du corps et politique dans le roman arabe contemporain.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.